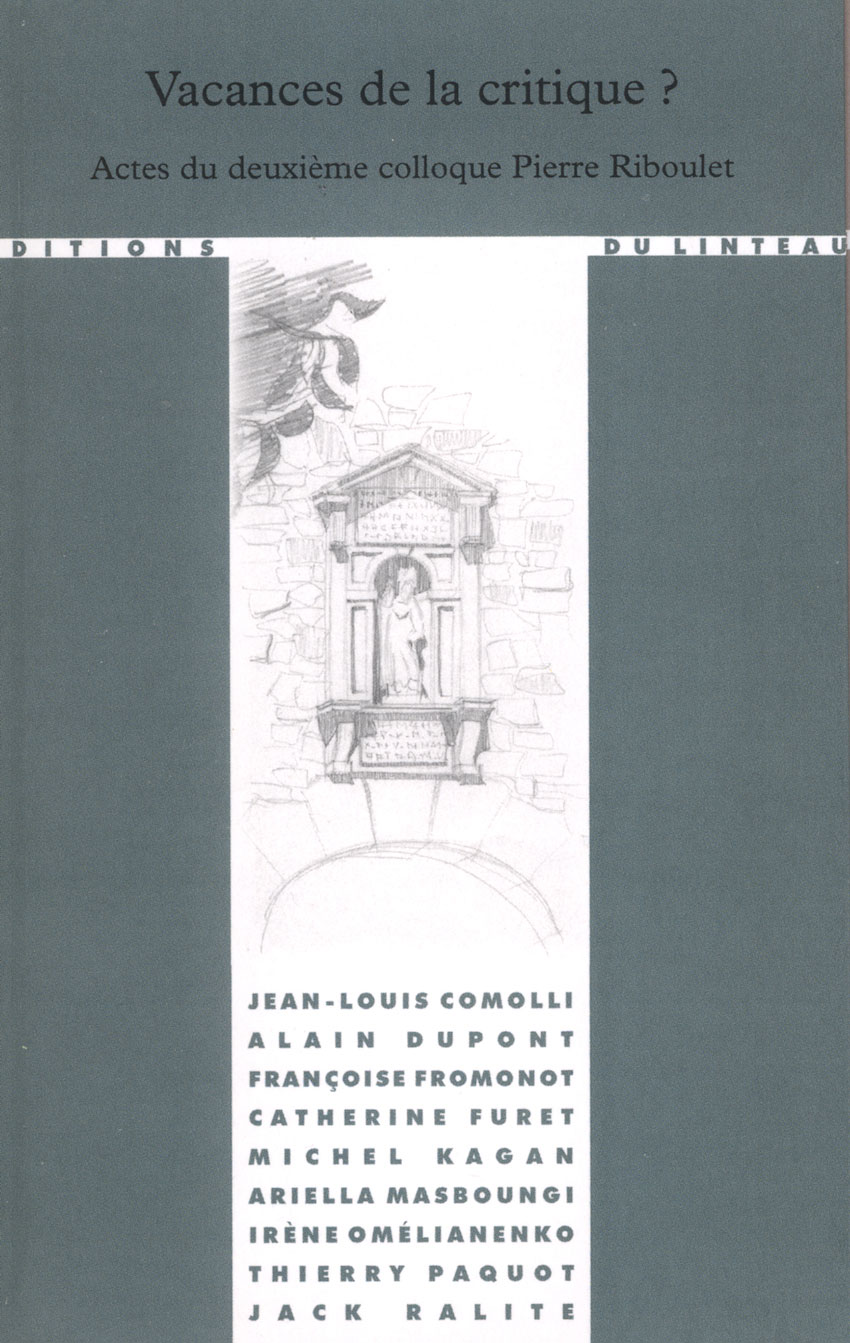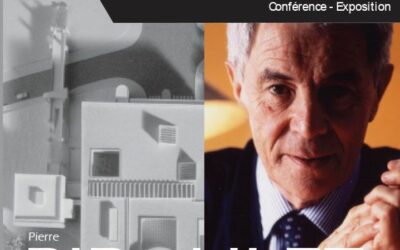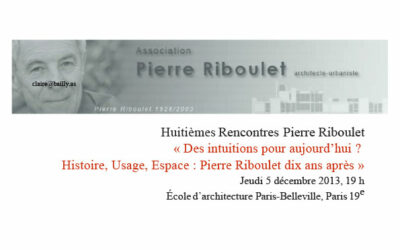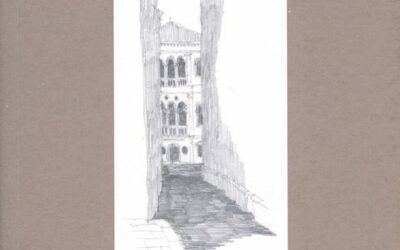2007, Vacances de la critique ?
Amphithéâtre du siège de la société Colas, Boulogne
Intentions
La critique des pratiques artistiques (littérature, cinéma, peinture… architecture) a-t-elle vécu, est-elle dévoyée ou se prépare-t-elle secrètement à jouer le rôle nouveau qui manque à notre époque ? Après le thème du temps, abordé en 2006, le deuxième colloque pierre-riboulet se propose de confronter l’architecture et la société dans laquelle elle œuvre autour de ce nouveau sujet. Où en est la critique aujourd’hui, et où en sommes-nous, créateurs comme usagers, de nos rapports avec elle ? Quelle fonction remplit-elle (repérage, distinction, jugement), ou ne remplit-elle plus ? Doit-elle être laissée aux experts, confiée aux seuls journalistes, déléguée aux amateurs éclairés, réservée aux créateurs ou laissée en libre accès ? Doit-elle se réfugier dans la théorie, dans l’Histoire ? Quels rapports doit-elle entretenir avec l’innovation (trop lointaine elle la rate, trop proche elle la courtise) ?
Notre envie de réflexion est née du constat de malaise largement partagé par les créateurs et les « usagers » de la création, acteurs du monde de l’architecture comme des autres disciplines, à l’égard de la critique : comment penser la complexité grandissante du monde, et la difficulté concomitante à y déceler ce qui, dans les villes mais aussi les livres, les films, partout où naît l’acte créateur, se joue, s’affronte, parade ou s’installe, s’il faut se résigner simultanément à une certaine vacance de la critique qui, toute occupée du jugement de valeur, paraît renoncer à situer, hiérarchiser, prévoir, parier, avoir déjà fait le deuil de son objet et de sa propre pérennité ? Pour n’être pas que tribut payé à la mode éphémère, comment la critique doit-elle se construire, et concilier l’indispensable impertinence avec le sérieux du travail de culture ?
Programme
Introduction, par Alain Dupont, PDG de Colas
Dialogue 1*
Y a-t-il une critique légitime ?
Michel Kagan, architecte, débat avec Thierry Paquot, philosophe
Dialogue 2*
Entre marché, communication et innovation, quelle place pour la critique ?
Françoise Fromonot, architecte, débat avec Jack Ralite, sénateur
Dialogue 3*
Quand la critique s’éveillera-t-elle ?
Jean-Louis Comolli, cinéaste, débat avec Catherine Furet, architecte
Synthèse des débats et conclusion
par Ariella Masboungi
Intervenants
Alain Dupont
Président-directeur général de la société Colas depuis 1987, il a cultivé une longue et fructueuse collaboration avec Pierre Riboulet, lui confiant la réalisation de nombreux bâtiments (laboratoire de recherche de Magny-les-Hameaux, sièges régionaux de Nantes et Lyon, siège social de Boulogne-Billancourt…). Il est à ce titre le seul maître d’ouvrage privé avec lequel Pierre Riboulet ait travaillé.
Michel Kagan
Né en 1953 à Paris, il est architecte-conseil au ministère de l’équipement, des transports et du logement et professeur à l’École d’architecture de Paris-Belleville. Il a réalisé entre autres un programme de cinquante logements et ateliers d’artistes rue Saint-Charles à Paris (projet nominé prix Mies Van der Rohe).
Thierry Paquot
Philosophe, professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris, il réfléchit à tous les aspects de l’urbanisme, comme en témoigne le récent La Ville au cinéma (codirigé avec Thierry Jousse, Éditions Cahiers du cinéma). Collaborateur régulier de France Culture ou du Monde diplomatique, il est depuis 1994 rédacteur en chef et éditeur de la revue Urbanisme. Il a également rédigé un Petit manifeste pour une écologie existentielle ainsi qu’un Art de la sieste…
Françoise Fromonot
Architecte et critique, elle enseigne à l’école d’architecture de Paris-la Villette. Elle est, entre autres, l’auteur du récent et remarqué La Campagne des Halles : les nouveaux malheurs de Paris. Lauréate du Prix du livre d’architecture en 1999 et 2003, elle a été corédactrice en chef de la revue critique Le Visiteur et contribue régulièrement à diverses publications françaises et internationales.
Jack Ralite
Né en 1928 à Chalons-sur-Marne, il a été député de 1973 à 1981, maire d’Aubervilliers de 1984 à 2003, ministre de la santé de François Mitterrand. Il est sénateur de la Seine-Saint-Denis depuis 1995. Bien connu pour sa sensibilité et sa connaissance des enjeux culturels, il participe activement aux grands débats qui agitent la société française (la question du droit d’auteur par exemple).
Jean-Louis Comolli
Né en Algérie en 1941, Jean-Louis Comolli a été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1965 à 1972. Il a ensuite réalisé quelques longs métrages de fiction (la Cécilia en 1975, l’Ombre rouge en 1981) avant de se tourner vers le documentaire. On lui doit entre autres une passionnante série de films sur Marseille (1989-2003). Très attentif aux questions d’architecture et d’urbanisme, il a réalisé en 1991 l’“adaptation” de Naissance d’un hôpital avec Pierre Riboulet. Il est également grand amateur de jazz, conférencier, professeur à Paris-VIII…
Catherine Furet
Née en 1954, architecte depuis 1980, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis (Académie de France à Rome, 1982-1984) et titulaire d’un DEA d’histoire à l’École des hautes études en sciences sociales, elle a réalisé de nombreux immeubles de logements en province et en région parisienne. Elle est également professeur et architecte conseil de la ville de Lyon depuis 2001.
Ariella Masboungi
Architecte urbaniste en chef de l’État, chargée de la mission Projet urbain auprès du directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction du ministère de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, elle dirige également les Ateliers Projet urbain, lieux d’échanges et de débats repris dans la collection éditoriale « Projet urbain ».
Actes
Rencontres
2015. Exposition-Conférence Paris-8
L’Université Paris 8 organise, à l’occasion du 20ème anniversaire de la pose de la 1re pierre de la bibliothèque universitaire, une exposition sur les bibliothèques de Pierre Riboulet.
2013. Des intuitions pour aujourd’hui ?
Histoire, usage, espace : Pierre Riboulet dix ans après. 5 décembre 2013, 19 h. École d’architecture de Paris-Belleville.
2012. Peurs d’aujourd’hui, création de demain
Mercredi 28 novembre 2012, 19 h. Ecole d’architecture de Paris-Belleville. La question s’adresse, par-delà l’architecture, à toute la société.
2011, A qui profite la norme ?
À l’heure où la norme technique exerce, en architecture comme ailleurs, une pression grandissante, il nous semble nécessaire de nous interroger sur ce qui est vécu comme une dérive par nombre d’entre nous.
2010, L’espace sens dessus dessous
Urbanisme et architecture se nichent au cœur de ces questions : peut-on aménager, construire sans s’inscrire dans la longue durée, sans proposer un sens, offrir une possibilité tangible de savoir où l’on est ?
2009, Les clefs de la transmission
30 novembre 2009, lycée Le Corbusier, Aubervilliers. Quatrième Rencontre dans l’un des bâtiments que Pierre Riboulet a construits en banlieue.
2008, Métamorphoses de l’engagement
19 novembre 2008, Cité de l’Architecture, Paris. Pourquoi l’effort collectif est-il aujourd’hui mis au service de l’individualisme ?
2006, Le temps, la ville et l’architecte
On distingue volontiers les arts du temps (littérature, théâtre…) des arts du visible (peinture, sculpture…), mais les uns comme les autres affrontent la redoutable question de l’inscription temporelle : la durée.