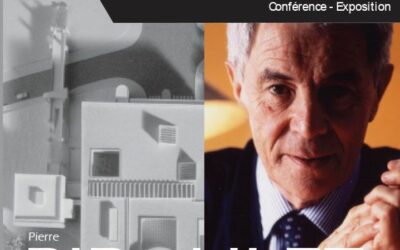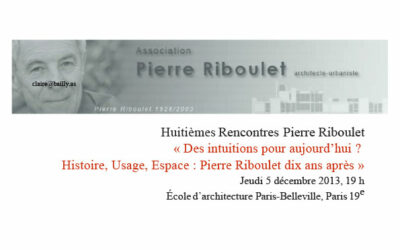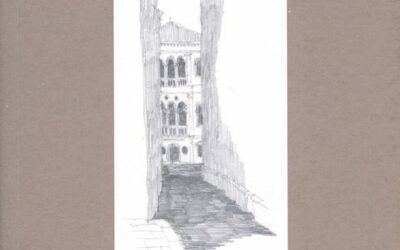2010, L’espace sens dessus dessous
Intentions
De tous temps la question de l’orientation, la possibilité de définir la place occupée par les hommes sur la terre, mais aussi dans l’histoire, ou plus simplement dans l’espace, privé ou public, ont été déterminantes, ont produit quantité de biens précieux pour la connaissance (des relevés cadastraux du Moyen Âge à Google Earth, des multiples propositions de représentation de l’espace par la peinture à la matérialisation et l’occupation de l’espace par l’architecture et l’urbanisme).
Le phénomène que nous vivons actuellement sous le nom de « mondialisation » engendre un certain nombre de changements dans les modes de représentation de l’espace (mutation et uniformisation des repères induisant une paradoxale désorientation dès que ceux-ci viennent à se transformer, ou à manquer), partant dans les idées qu’on s’en fait et dans les usages qu’on en a.
Urbanisme et architecture se nichent au cœur de ces questions : peut-on aménager, construire sans s’inscrire dans la longue durée, sans proposer un sens, offrir une possibilité tangible de savoir où l’on est ? Ainsi, par exemple, implanter un axe de circulation ou un bâtiment sur le plan enfoui de la cité romaine depuis longtemps disparue n’est pas une tentation passéiste mais une volonté de situer le monde habité dans une continuité propre à tracer des chemins comme à éclairer l’avenir.
19 h 30
Introduction : les réponses de la bibliothèque de l’université Paris-8
aux problèmes de l’organisation de l’espace, par Nathalie Régnier-Kagan, architecte
20 h 00
Comment vivre sans repères ?
Conversation avec Jacques Lévy, géographe
20 h 40
Les mutations de l’espace public
Conversation avec Élisabeth Pélegrin-Genel, architecte et urbaniste
21 h 20
Les vertus du contexte
Conversation avec Philippe Panerai, architecte et urbaniste
22 h 00
Débat avec les intervenants et le public
Intervenants
Jacques Lévy
Géographe et urbaniste, professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, il y dirige le Laboratoire Chôros. Il y est aussi codirecteur du Collège des Humanités. Ses centres d’intérêts principaux sont la théorie de l’espace des sociétés, notamment à travers la géographie du politique, des villes et de l’urbanité, de l’Europe et de la mondialisation. Il s’intéresse à l’épistémologie des sciences sociales et aux méthodes des sciences sociales, avec une attention particulière pour la cartographie. Dans son activité professionnelle, il s’emploie à relier et à associer la recherche fondamentale aux pratiques de l’urbanisme et du développement spatial. Il a été professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (1989-2007) et professeur invité dans de nombreuses universités étrangères. Il est codirecteur de la revue EspacesTemps.net et collabore avec plusieurs journaux et chaînes de radio. Il est également l’auteur de très nombreux articles et ouvrages.
Philippe Panerai
Architecte et urbaniste (grand prix national d’urbanisme 1999), Philippe Panerai travaille sur la question urbaine à partir de trois axes : la formation du tissu urbain et les manières d’habiter la ville contemporaine ; le projet d’espaces publics et l’intégration des infrastructures techniques ; l’échelle territoriale et la forme de l’agglomération. Il est l’auteur de nombreuses communications sur ces sujets et de quelques ouvrages, parmi lesquels Paris Métropole, Formes et échelles du Grand Paris (Éd. La Villette, 2008). Ses projets récents mêlent la grande échelle (Reims métropole, Grand Paris), le renouvellement urbain et les éco-quartiers. Il a également enseigné dans différentes écoles d’architecture (Versailles, Paris-Villemin, Paris-Malaquais dont il a été le responsable) et à l’Institut français d’urbanisme, et il est professeur associé à la faculté d’architecture de l’université fédérale du Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brésil).
Élisabeth Pélegrin-Genel
Architecte et psychologue du travail, Élisabeth Pélegrin-Genel intervient en entreprise, depuis une quinzaine d’années, comme consultante sur les problèmes d’espace, de travail et d’organisation (impacts du bureau paysager, problématiques de changement d’espaces de travail, d’accompagnement du changement ou encore de situations critiques d’accueil). Elle développe également, au sein de l’agence Architecture Pélegrin, avec François Pélegrin, différents projets de recherches et développement sur le bureau à énergie positive et l’habitat bioclimatique avec des équipes d’ingénieurs, d’industriels et d’architectes. Elle enseigne par ailleurs à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse un module pour les étudiants de 3e année « Écrire l’architecture ». Elle est enfin l’auteur de plusieurs ouvrages sur les bureaux ou la maison. Le dernier paru, Des souris dans un labyrinthe, décrypter les ruses et manipulations de nos espaces quotidiens (la Découverte-les Empêcheurs de penser en rond, avril 2010), étend la réflexion aux espaces extérieurs, publics.
Nathalie Régnier-Kagan
Nathalie Régnier-Kagan, architecte, est titulaire d’un DEA sur « le projet architectural et urbain » (Paris-8-Institut français d’urbanisme, 1994). Après avoir collaboré à l’agence Richard Meier & Partners à New York en 1990, puis à l’agence Pierre Riboulet à Paris comme chef de projet de 1991 à 1992, elle participe en son nom propre à des concours d’architecture et réalise des maisons individuelles et des rénovations en Charente-Maritime. Elle collabore ensuite, comme assistante puis associée, avec Michel Kagan, de 1992 à la disparition de ce dernier en 2009. Elle est aujourd’hui gérante de la société et poursuit l’œuvre entreprise avec Michel Kagan. En parallèle de son activité d’architecte praticienne, elle enseigne la théorie et la conception du projet architectural et urbain en tant que maître-assistante titulaire dans les écoles nationales supérieures d’architecture depuis 1994 (Rennes de 1994 à 1997, Versailles de 1997 à 2007, Paris-Val de Seine depuis 2007).
Dossier de presse
Affiche de l'exposition
Affiche des 5e rencontres
Ecouter les débats
Extrait 1
Extrait 2
Rencontres
2015. Exposition-Conférence Paris-8
L’Université Paris 8 organise, à l’occasion du 20ème anniversaire de la pose de la 1re pierre de la bibliothèque universitaire, une exposition sur les bibliothèques de Pierre Riboulet.
2013. Des intuitions pour aujourd’hui ?
Histoire, usage, espace : Pierre Riboulet dix ans après. 5 décembre 2013, 19 h. École d’architecture de Paris-Belleville.
2012. Peurs d’aujourd’hui, création de demain
Mercredi 28 novembre 2012, 19 h. Ecole d’architecture de Paris-Belleville. La question s’adresse, par-delà l’architecture, à toute la société.
2011, A qui profite la norme ?
À l’heure où la norme technique exerce, en architecture comme ailleurs, une pression grandissante, il nous semble nécessaire de nous interroger sur ce qui est vécu comme une dérive par nombre d’entre nous.
2009, Les clefs de la transmission
30 novembre 2009, lycée Le Corbusier, Aubervilliers. Quatrième Rencontre dans l’un des bâtiments que Pierre Riboulet a construits en banlieue.
2008, Métamorphoses de l’engagement
19 novembre 2008, Cité de l’Architecture, Paris. Pourquoi l’effort collectif est-il aujourd’hui mis au service de l’individualisme ?
2007, Vacances de la critique ?
Le deuxième colloque Pierre Riboulet se propose de confronter l’architecture et la société dans laquelle elle œuvre autour de ce nouveau sujet.
2006, Le temps, la ville et l’architecte
On distingue volontiers les arts du temps (littérature, théâtre…) des arts du visible (peinture, sculpture…), mais les uns comme les autres affrontent la redoutable question de l’inscription temporelle : la durée.